|
Savoie, France- 25.07.10
Les bijoutiers
d’Ath-Yenni. La construction d’une attractivité territoriale sur les
savoir-faire artisanaux ancestraux (aux Editions ACHAB)
Le pays amorce sa réouverture, la sécurité
revient pas à pas et les touristes seront bientôt de retour en Algérie. La
valorisation des patrimoines culturel, naturel et artisanal est alors
nécessaire. Nécessité dont le monde associatif (je pense à l’association
culturelle Tigejdit pour la poterie kabyle par exemple) et plus récemment les
pouvoirs publics ont bien compris l’intérêt (fonds de promotion, exonérations
fiscales, mise en place de l’approche Nucleus…).
La Kabylie est riche de sa culture et de ses
savoir-faire véritablement ancrés dans le territoire (bijouterie, poterie,
tissage…). Si j’ai choisi de travailler spécifiquement sur la Kabylie c’est que
pour des raisons personnelles je viens régulièrement dans cette région dans
laquelle j’ai des attaches. J’ai d’ailleurs déjà travaillé sur le thème de la
relance de l’artisanat en Algérie, et en Kabylie en particulier, en étudiant la
mise en place de l’approche Nucleus.
Le livret d’étude intitulé « Les bijoutiers
d’Ath-Yenni. La construction d’une attractivité territoriale sur les
savoir-faire artisanaux ancestraux » publié aux Éditions Achab s’inscrit
dans la continuité de ces travaux. Les questions soulevées dans cette recherche
sont essentiellement : Comment valoriser le patrimoine ? Comment structurer les
acteurs du territoire ? Comment remettre l’artisan, son savoir-faire et sa
créativité au cœur d’un processus de développement systémique ?
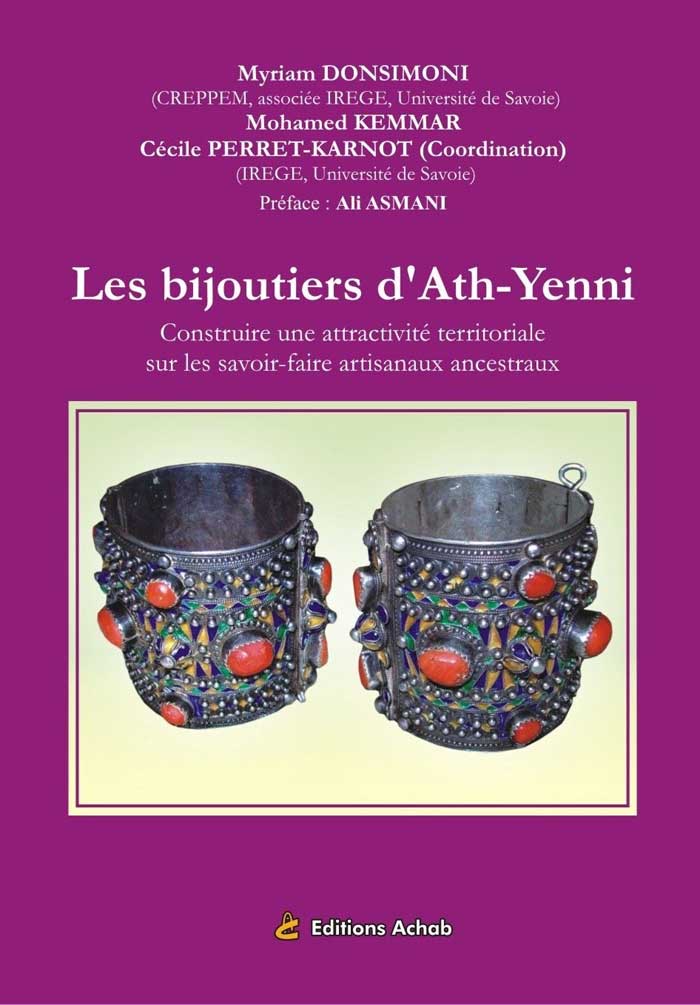
Le territoire que j’ai choisi, point de départ de cette
recherche, est celui des Ath-Yenni car il est chargé d’histoire, riche de ses
paysages et des savoir-faire ancestraux des bijoutiers qui en firent la renommée
et la fortune. D’autre part, l’objet bijou en lui-même est très intéressant
puisqu’il a un fort contenu symbolique (motifs, couleurs), il est une réserve de
valeur et il se transmet de génération en génération entre les femmes.
Pour réaliser ce travail, nous avons à la fois mobilisé les
outils théoriques traditionnels du développement territorial et du capital
social, car les facteurs sociaux (échanges informels, structures des réseaux
sociaux, pratiques solidaires, Nucleus, etc.) influent sur le développement
territorial, et effectué un travail de terrain en allant à la rencontre des
artisans ou des acteurs du territoire. Certains artisans bijoutiers ont même
eu la gentillesse de répondre à un questionnaire, ce qui n’est pas forcément
naturel dans les sociétés à forte tradition ; qu’ils en soient remerciés.
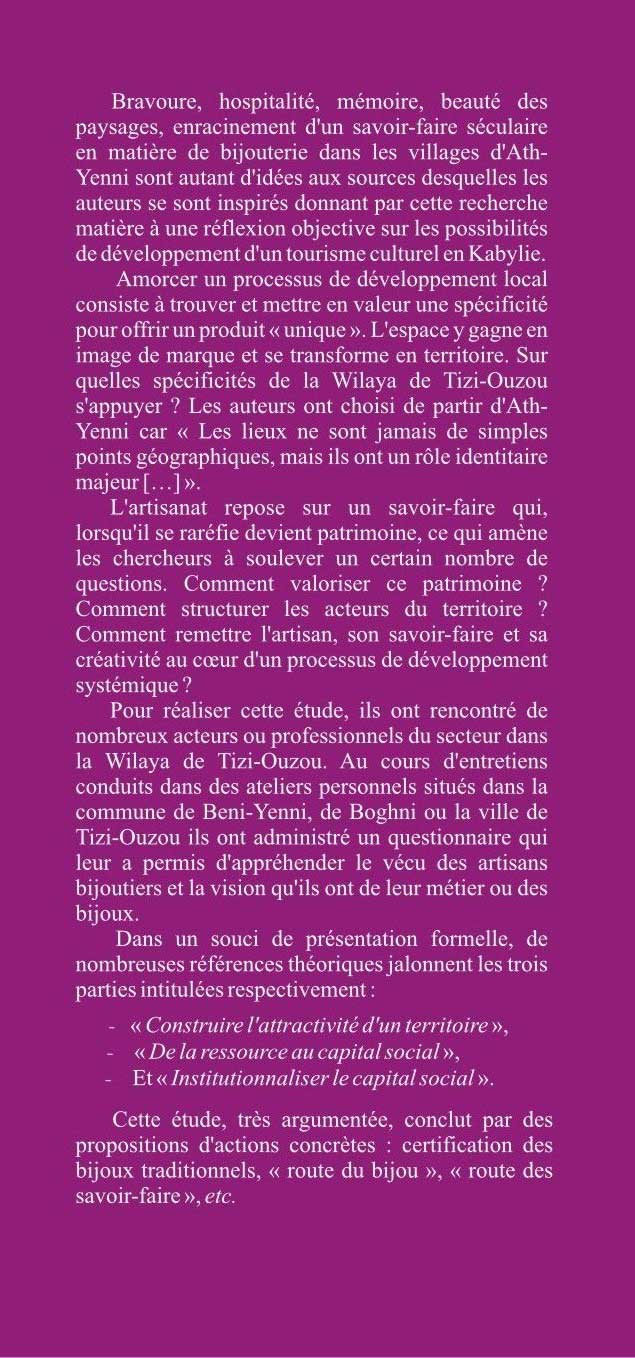
Sur les 14
artisans qui ont répondu au questionnaire, 6 ont encore leur entreprise
localisée dans la commune de Beni-Yenni (Ath Lahcen, Tigzirt ou Agouni Ahmed) et
11 déclarent avoir une origine familiale dans cette commune (en majorité Ath-Lahcen).
Si nous sommes tout à fait conscients que la taille de l’échantillon d’artisans
sur lequel nous avons travaillé est réduite, il n’en reste pas moins que leurs
réponses nous apportent des indications précieuses sur les problèmes qu’ils
rencontrent : approvisionnement en matières premières, écoulement de la
marchandise… Mais faire un constat n’étant pas suffisant nous les avons
également interrogé sur les solutions envisageables pour les aider. Nos
conclusions tiennent compte de l’ensemble des idées, remarques… qui nous ont été
faites et nous espérons ne pas les avoir trahies.
Un certain nombre de propositions d’action concluent cette
étude : certification des bijoux traditionnels, ouverture de la fête du bijou
aux artisans bijoutiers de toute la Wilaya, structuration d’une organisation
professionnelle performante, circuits touristiques… La « route du bijou » ou la
« route des savoir-faire » (dont nous ébauchons un tracé partant de Tizi-Ouzou)
doivent bien évidemment être considérées comme des pistes possibles pouvant
donner matière à discussion aux acteurs du territoire et être affinées. Le rôle
de l’universitaire n’est que d’analyser une situation de la manière la plus
objective possible.
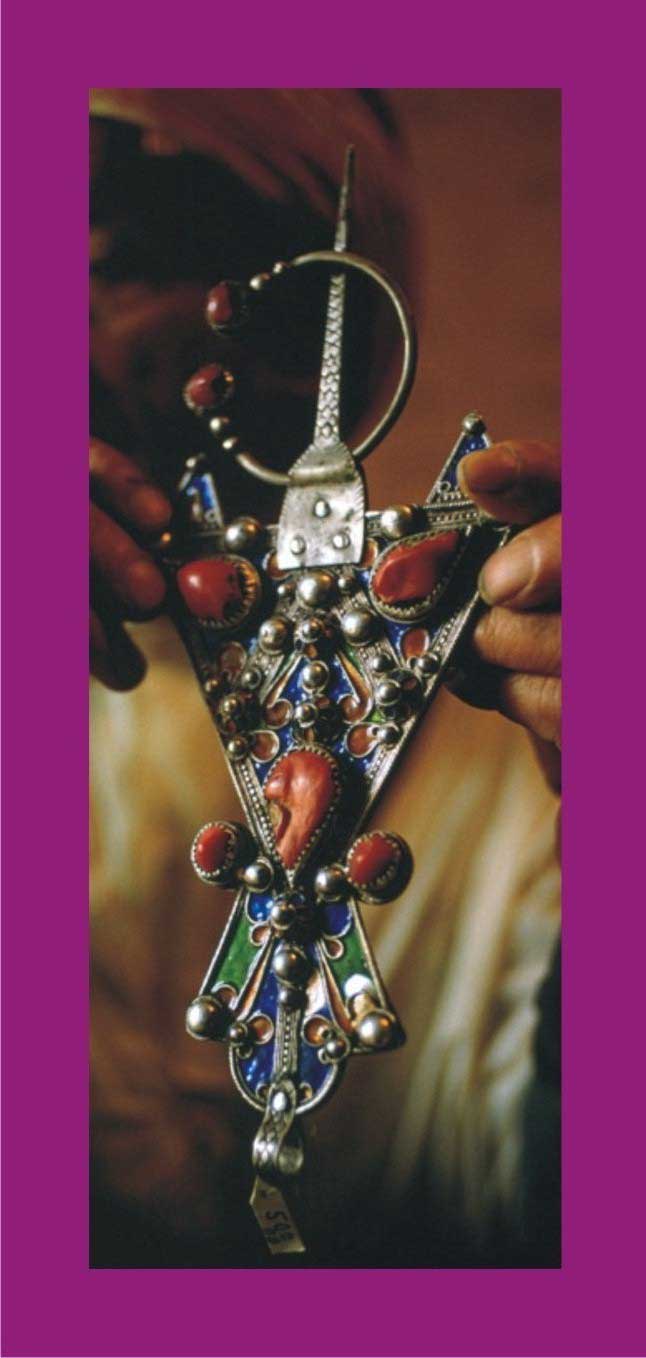
Ce qui est certain c’est que la Kabylie dispose d’atouts
considérables qui sont valorisables, dont l’hospitalité extraordinaire de ses
habitants. Attention cependant, il ne faut pas oublier qu’il existe également
des risques d’impacts socioculturels négatifs du tourisme : l’érosion des
identités et des valeurs autochtones, les chocs des cultures, les conflits pour
l’usage des ressources…
Cécile Perret (Maître de conférences, IREGE, Université de
Savoie)
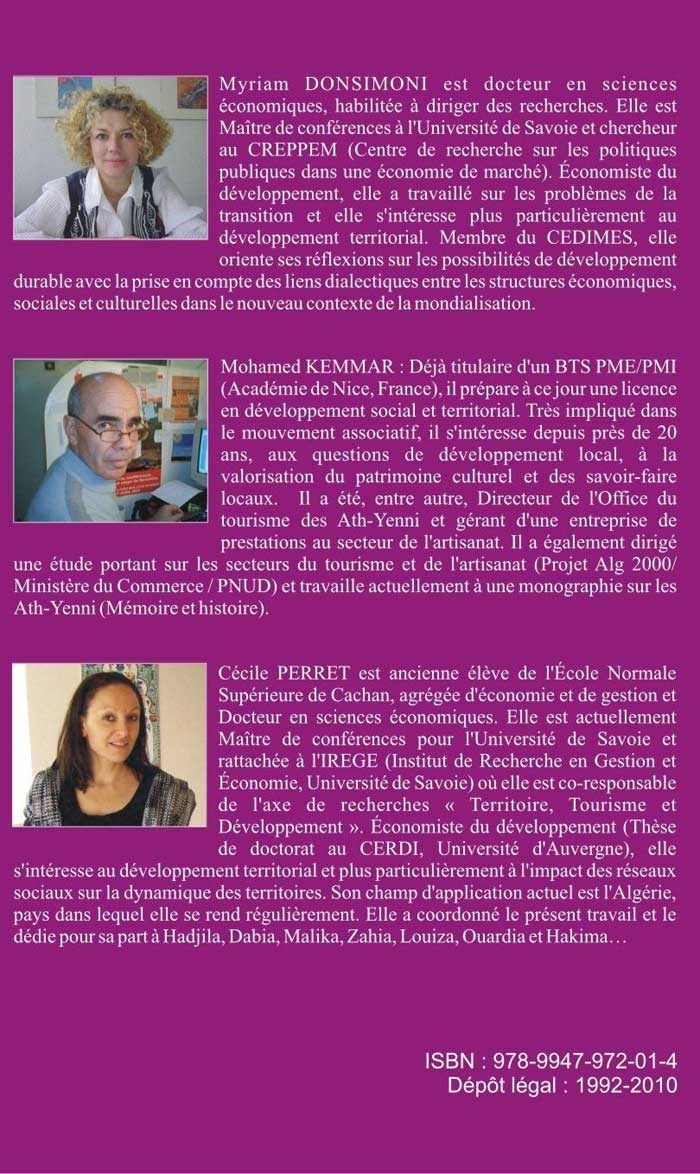
|